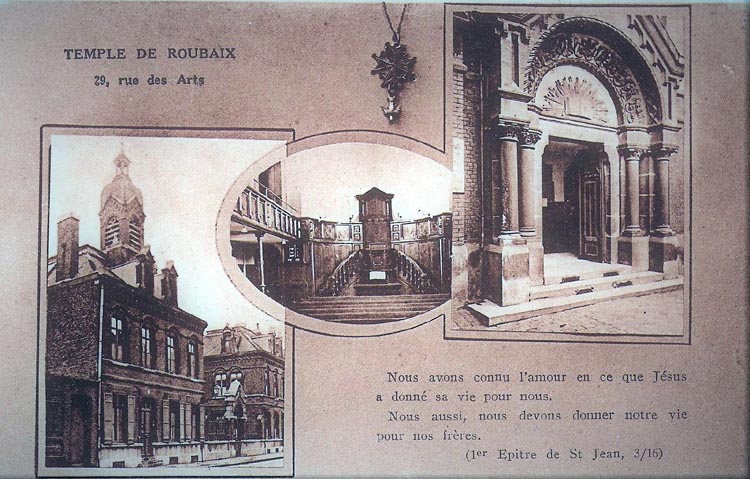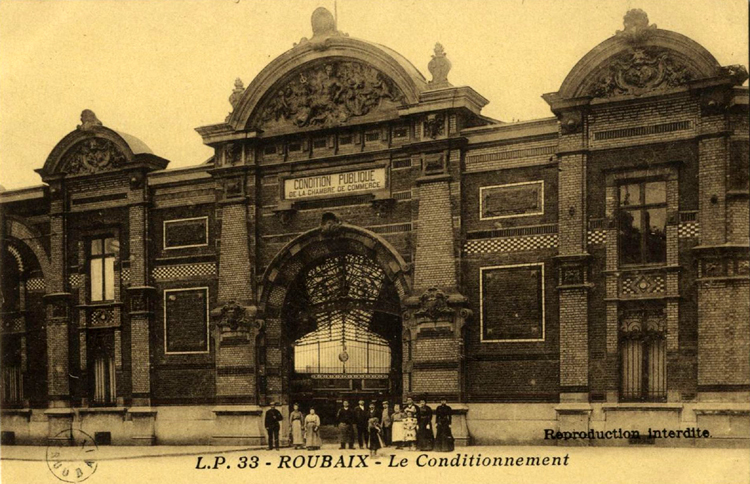SUR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER DE SOMAIN A ROUBAIX-TOURCOING
En 1860, le Maire de Lannoy est informé de la mise à l’étude d’un projet de ligne de chemin de fer reliant directement Lille à Tournai, en suivant jusqu’à Baisieux, la route dite « Impériale ».
L’administration municipale de la commune établit un contre-projet faisant passer cette nouvelle ligne par Mons-en-Baroeul et Flers, pour la rapprocher de Lannoy où serait installée une station, puis rejoindrait le chemin de fer belge à Templeuve en Dossemez.
Pour justifier de l’utilité de ce tracé, le Maire propose qu’il y ait un embranchement partant de Lannoy et rejoignant Roubaix, ce qui relierait, à moindres frais, cette ville à Tournai. Malgré de nombreuses démarches et l’appui du Conseil municipal de Roubaix, ce contre-projet n’aura pas de suite.
Le 10 juillet 1868, il est fait une première mention du projet d’une ligne de chemin de fer devant relier Somain à Roubaix-Tourcoing pour assurer le ravitaillement en charbon des grandes cités textiles.
Le décret impérial du 25 mai 1869 accorde à la Compagnie des chemins de fer du Nord-Est, la concession de la ligne, soit 40,6 km entre Somain et Roubaix-Tourcoing, par Orchies et Cysoing. La concession est à titre éventuel, les formalités d’enquête n’étant pas encore réalisées. Les travaux devront être entrepris un an plus tard et terminés en six ans. Cette ligne, prévue seulement pour les convois de marchandises, devait passer par Lys-lez-Lannoy, longer la ville de Lannoy et traverser en plusieurs endroits les cultures de la commune de Hem.
Le 10 octobre 1868, le Conseil municipal de Lys s’était uni aux communes environnantes pour demander la mise à l’étude de cette ligne. Les parlementaires de la région, avec à leur tête le dynamique Jules Brame, font circuler une pétition favorable, mais le Conseil municipal de Hem, méfiant, ne fait aucun commentaire et le 19 décembre 1869, l’ingénieur en chef des lignes du Nord, demande à rencontrer le Maire de la commune. Il dut être persuasif, car cette fois, le Conseil est tout à fait d’accord et insiste immédiatement pour obtenir une gare à Hem, la plus proche possible du centre de la commune. Comme les habitants d’Annappes ont également envie du train, en octobre 1871 les Hémois font, à leur tour, circuler une pétition pour obtenir que la gare reste sur leur territoire.
En juin 1871, le Préfet du Nord demande à tous les Conseils municipaux de délibérer sur la position des stations du chemin de fer. Il n’y a aucune objection de la part des Conseillers de Lys puisque leur commune devait être équipée d’une station se situant à proximité des établissements industriels de Boutemy. Cependant, MM. Henri Delattre et Louis Dubar demandent qu’elle soit reportée de l’autre côté de la route, cet emplacement devant être plus favorable aux intérêts des pauvres de Lys puisque la station devait être construite sur un terrain leur appartenant et qu’ils en perdraient les bénéfices de la mise en location.
A Toufflers, le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des plans dressés par l’ingénieur, délibère qu’il n’a aucune observation à présenter car l’emplacement des stations et le tracé de la ligne ne touchaient aucunement au territoire de la commune.
A Hem, la consternation est grande car aucune gare n’y est prévue. Les Conseillers vont trouver le Maire de Lannoy qui, justement, est commissaire-enquêteur, puis rédigent un rapport dans lequel ils demandent d’obtenir une gare à Hempenpont. Ce hameau, très industriel, comprend 19 générateurs à charbon sur les 21 existants dans la commune. Ce chiffre était très probablement exagéré, mais il est important de signaler que, dans ce secteur, une ligne de teinturerie s’était implantée le long de la Marque. Depuis longtemps, il existait une tradition de blanchisseries au bord de cette rivière. La teinturerie demandant beaucoup d’eau, cela posait un problème à la ville de Roubaix : la Marque fournissait l’eau et permettait les rejets des polluants. Cette activité attira un fabricant de teinture chimique et, après 1870, cinq autres teintureries s’y installèrent.
Pour faire fonctionner les chaudières, ce secteur d’activité aurait eu besoin de plus de 1 200 wagons de houille par an et il faillait prévoir également le transport de grains, de produits chimiques et de produits de sucrerie.
Le 12 janvier 1875, le tracé définitif de la ligne de chemin de fer est publié. A Hem, c’est la consternation car la voie ferrée supprime le passage des véhicules et des piétons sur six chemins de la commune, ce qui cause le plus grand préjudice aux cultivateurs.
A la demande des fermiers, le Conseil municipal réclame immédiatement des chemins latéraux à la voie, quatre passages à niveau et un pont sur la grande route. Il demande également que les aqueducs et courants d’eau interrompus soient rétablis en priorité, étant donné les dangers d’inondation.
La question de la gare de Hem n’est toujours pas réglée et le Conseil municipal réclame qu’il y ait au moins une halte au chemin du Calvaire. Mais dans la commune, les partisans et les détracteurs de la linge continuent de s’affronter.
La Compagnie du Nord a repris, au premier janvier 1876, l’exploitation des lignes construites par la Compagnie du Nord-Est, notamment celle de Somain à Orchies, déjà en exploitation sur 16,2 km.
En décembre 1876, la construction est commencée et les ingénieurs souhaitent déplacer la rivière dite « vieille Marque » ainsi que la route départementale de Forest et les rendre parallèles au train sur une longueur de 400 mètres. Les Conseillers ne sont pas d’accord et prétendent que, affolés par les locomotives, les chevaux en s’emballant risquent de se jeter à l’eau ou de causer de graves accidents.
En juillet 1877, le Préfet revient à la charge pour la déviation de la route, mais le Maire maintient son opposition et réclame des passages à niveau. Ce sont finalement les ingénieurs qui gagnent la partie.
A Lys, les habitants rédigent une pétition demandant le maintien du sentier qui fait communiquer le quartier de Cohem avec la route départementale au niveau du carrefour de la Justice. La Compagnie du chemin de fer est invitée à rétablir le passage pour piétons supprimé, ce qui sera fait l’année suivante avec la participation de la commune pour un montant de 460 francs.
Le 8 juillet 1878, le Ministre ayant approuvé la dénomination de Lannoy-Lys pour la gare du chemin de fer, le Conseil municipal de Lys conteste les arguments avancés par le Maire de Lannoy à l’origine de ce choix et prie Monsieur le Ministre de revenir sur sa décision.
Il faut savoir que depuis longtemps, la ville close de Lannoy, à l’étroit entre ses remparts, souhaitait agrandir son territoire et s’étendre plus particulièrement en direction de Roubaix, c’est-à-dire sur le territoire de Lys où se trouvaient justement les industries florissantes.
Après une première tentative en 1835, puis une autre en 1865, qui chacune dura plusieurs années, le Préfet décide le 17 septembre 1867, l’annexion pure et simple de Lys à Lannoy, pour ne former qu’une seule commune qui prendra le nom de Lannoy-Lys et dont le chef-lieu est fixé à Lannoy. Heureusement, après de nombreuses démarches et manifestations, le Conseil d’Etat annule le 14 février 1868, pour excès de pouvoir, l’arrêté du Préfet. Il faut donc comprendre la colère des habitants de Lys, lorsque dix ans après cette victoire, on leur annonce que la gare portera le nom de Lannoy-Lys, plutôt que celui de Lys-lez-Lannoy, ce qui leur paraissait plus logique puisque la station se trouvait sur leur commune.
Toujours à Lys, le 20 août 1878, le Conseil municipal donne un avis favorable à la demande de Monsieur Boutemy de faire traverser la carrière du Bois par une ligne de raccordement entre son établissement de filature de lin et le chemin de fer car son usine, qui comprend 30 000 broches et occupe 1 500 ouvriers, consomme près de 1 200 tonnes de houille par mois et met en œuvre chaque mois, 150 tonnes de lin et 20 tonnes de matériaux divers. La station de Lannoy-Lys, avec une halle aux marchandises, est construite la même année.
Suite à une décision du Ministre des travaux publics, la section Orchies-Tourcoing est livrée à l’exploitation en 1879. Le 26 juillet de cette même année, le Conseil municipal de Lys, demande l’expropriation, pour cause d’utilité publique, d’un terrain en forme de triangle, obstruant par une clôture l’entrée de la gare et appartenant à M. Pollet-Jonville de Roubaix. Le 3 mars 1881, le Conseil vote 1 000 francs pour l’achat de ce terrain et demande la dispense des formalités de purge des hypothèques.
Le 5 août 1881, l’entreprise Boutemy obtient du Préfet l’autorisation de mettre en service une locomotive sur l’embranchement qui relie son établissement à la gare de Lannoy. C’est cette même année que les trains vont commencer à circuler sur la ligne et la compagnie propose à la ville de Hem la construction d’une halte, à condition que la commune en paye les frais. Les Conseillers municipaux, hostiles et outragés, sont d’avis d’attendre le sort réservé à un nouveau projet de ligne reliant La Madeleine à la Belgique et passant par Hem et Lannoy. Mais ce projet ne sera pas réalisé.
En 1886, la population se plaint de la barrière sur la route de Hem à Forest qui reste toujours fermée. Sur cette partie de la ligne, il ne circule que des wagons de charbon et la compagnie envisage la création de trains de voyageurs afin de drainer la main-d’œuvre vers le centre textile de Roubaix. Elle propose que si la ville de Hem souhaite une halte, elle en assume les frais elle-même.
Le Conseil, après maintes délibérations, finit par voter un crédit de 500 francs pour l’implantation d’un arrêt à la barrière au point dit « Ronde du Château ». Les premières statistiques connues concernant le trafic des voyageurs à ce point d’arrêt facultatif, datent de 1898 où l’on dénombre 21 215 voyageurs, soit près de 60 personnes par jour.
Sur la demande de MM. Parent et Desurmont, industriels au quartier du Petit-Lannoy, le Maire tente en vain d’obtenir une nouvelle halte pour desservir le hameau des Trois-Baudets et celui du Petit-Lannoy. Il n’y aura jamais de halte aux Trois-Baudets, et celle du Petit-Lannoy ne sera mise en service qu’en 1909, avec un trafic de 8 546 voyageurs par an, soit environ 23 par jour.
En 1890, les industriels hémois, qui ont demandé la construction d’une gare de marchandise, essuient un refus de la compagnie qui leur propose seulement un service de wagons complets, sans livraison de détail. Les habitants continuent toujours de se plaindre des embouteillages à la barrière, sur la route de Forest.
Le 22 décembre 1895, M. Echevin, Conseiller municipal de Lys, demande que l’on mette une sonnette à la barrière de Cohem pour servir lorsque le garde-barrière est couché. La demande est transmise à la compagnie. Quelques mois plus tard, le Conseil demande la substitution d’une barrière à bascule à celle qui existe car l’heure d’ouverture est trop tardive pour les cultivateurs qui doivent y passer le matin.
Le 22 mai 1895, un grave accident se produit à la gare de Lannoy-Lys. Nous en trouvons un article dans le Journal de Roubaix : « Un accident très pénible s’est produit mardi à deux heures de l’après-midi à la gare de Lys-lez-Lannoy. Monsieur Jules Fava, homme d’équipe, était occupé à accrocher des wagons, quand deux de ces voitures ayant reçu une poussée un peu trop forte, dépassèrent le point d’arrêt. Monsieur Fava voulu reculer pour les arrêter mais son pied ayant rencontré un obstacle, le malheureux tomba. Les roues des deux wagons lui passèrent sur le bras gauche qui fut coupé net, à la hauteur du coude. Les camarades de Monsieur Fava, épouvantés, s’empressèrent de relever l’infortuné qui poussait des cris déchirants. Il fut aussitôt transporté chez Monsieur Lagneau, pharmacien de la Compagnie du chemin de fer du Nord, qui lui donna les premiers soins en attendant l’arrivée de Messieurs les docteurs Lherbier et Petitpas. Après avoir examiné l’affreuse blessure, les deux médecins, ayant jugé nécessaire l’amputation, la pratiquèrent sur le champ. Monsieur Fava, qui est marié et père de six enfants, a été ensuite transporté à son domicile, au hameau de Cohem, à Lys-lez-Lannoy. Etrange coïncidence, le prédécesseur de Monsieur Fava, Monsieur Batarlie, avait lui aussi été victime d’un accident semblable en tout point ».
En 1896, le Conseil municipal de Hem étudie à nouveau le projet d’une gare de marchandises, mais celui-ci est ajourné par onze voix contre dix et un bulletin blanc. De justesse, les fermiers ont battu les industriels et Hem n’aura jamais sa gare pour les colis.
Le 4 décembre 1904, à la demande de Monsieur Jules Lepers, le Conseil municipal demande la construction d’un hall couvert à la gare de Lannoy-Lys. L’assemblée, sur la remarque de Monsieur Gossart, émet le vœu d’une amélioration de l’éclairage.
Le 27 septembre 1906 eut lieu à nouveau, à Lys, un grave accident qui coûta la vie à un ouvrier tisserand qui, vers vingt heures, longeait la voie ferrée à proximité de la barrière de Cohem. Tamponné par un train et projeté dans le fil d’eau qui longeait un des côtés de la voie, son corps ne fut découvert que le lendemain à 5 h 30 du matin.
En mars 1914, la municipalité de Toufflers réclamait des améliorations dans l’organisation et l’installation de la gare de Lannoy qui desservait la commune. Suite à cette intervention, le Ministre des travaux publics adressa au Préfet du Nord, pour être notifiée à Monsieur le Maire, la lettre suivante :
« Paris le 12 mars 1914,
Le Conseil municipal de Toufflers a signalé diverses défectuosités des installations de la station de Lannoy, notamment :
1° l’encombrement de la salle des pas-perdus par des colis
2° l’insuffisance de l’éclairage et du chauffage des salles d’attente.
En ce qui concerne le premier point, une décision ministérielle du 12 août 1913 a approuvé, pour l’extension du service des messageries à cette station, un projet dont la réalisation aura pour effet de supprimer la gêne éprouvée à certaines périodes du fait du dépôt des colis dans le vestibule.
Quant à l’éclairage et au chauffage, ils semblent assurés dans des conditions satisfaisantes, l’un au moyen de becs à gaz, système Auer, au parfait entretien desquels les agents de la Compagnie du Nord ont en charge de veiller tout spécialement, l’autre à l’aide d’un appareil tout à fait suffisant et en bon état, dont l’allumage et la conduite ont lieu régulièrement.
Dans ces conditions, le vœu du Conseil municipal ne me paraît susceptible d’aucune autre suite ».
Il y avait un trafic important à la gare de Lannoy-Lys : charbon, produits agricoles, drêches des brasseries, matières et produits textiles des usines nombreuses et importantes, sans oublier les voyageurs. 21 201 personnes par an en 1879, pour arriver avec une progression régulière à 60 867 en 1899, puis une diminution continue, pour n’atteindre que 46 968 voyageurs en 1908. L’année suivante, la chute de la fréquentation est brutale, 34 843 personnes, mais elle s’explique par la mise en service de la halte du Petit-Lannoy. Le trafic regroupé des deux stations relativement proches l’une de l’autre, donne une fréquentation de 43 389 voyageurs mais ne sera plus que de 34 447 en 1912.
L’arrêt des usines Boutemy en 1934, la suppression du service voyageurs avant 1939, provoqueront une diminution du trafic que l’installation des Etablissements Stein sur le site Boutemy ne parviendra pas à enrayer. La gare est désaffectée. Elle est démolie en 1983.
Bernard MOREAU (1930-2010)
Trésorier de la Société d’Emulation de Roubaix
Sources :
Délibération des Conseil municipaux de Lys, Lannoy et Toufflers
Articles du Journal de Roubaix
Ville de Lys, son histoire par Anthime Liénard
Lys à la Belle Epoque par le Cercle d’Etudes Historiques de Lys-lez-Lannoy
Hem, d’Hier et d’Aujourd’hui par André Camion et Jacquy Delaporte
Archives municipales de Roubaix : Série O VI (e) n° 3
A.D.N. – M 417/4147.