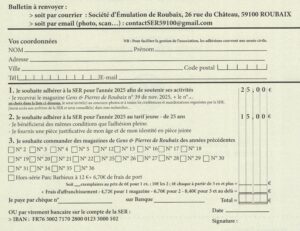Ce trait d’histoire locale est d’autant plus intéressant que ces trois Roubaisiens, mordus par un chien enragé, furent envoyés très rapidement par le Maire de Roubaix chez Louis Pasteur à Paris. L’annonce dans les journaux de la possibilité de guérison de cette maladie mortelle, a certainement influencé la décision rapide du Maire.
Qu’on en juge par les dates et les évènements relatés :
4 juillet 1885 : Le jeune alsacien Meister est vacciné et guéri par Louis Pasteur.
26 octobre 1885 : Communication de Pasteur sur « la méthode pour prévenir la rage après morsure » à l’académie des Sciences.
28 octobre 1885 : Le Maire Julien Lagache, au courant depuis quelques jours des cas de rage dans une cour de la ville, télégraphie à Louis Pasteur lui demandant s’il peut les traiter. Réponse affirmative.
3 novembre 1885 : Les trois malades partent à Paris, Louis Pasteur les vaccine.
12 novembre 1885 : Retour des trois Roubaisiens guéris.
DES CAS D’HYDROPHOBIE A ROUBAIX, RUE DE SOUBISE, JOURNAL DE ROUBAIX DU MARDI 27 OCTOBRE 1885
« Depuis un mois, on ne parle dans la région que de cas d’hydrophobie (synonyme de rage, dont la peur morbide de l’eau, est un des principaux symptômes). S’il faut évidemment, dans les rumeurs qui circulent à ce sujet, faire la part de l’exagération populaire, il n’est pas moins vrai qu’on a rarement vu autant de chiens enragés qu’en ce moment. C’est à croire qu’une véritable épidémie rabique affecte la race canine. Disons à ce propos que la chaleur n’influence pas comme on pourrait le penser sur le développement de l’hydrophobie. On l’observe dans toutes les saisons et ce sont même les mois de mars, d’avril, de septembre et d’octobre qui fournissent le plus de cas de cette terrible maladie.
Un petit griffon de race bâtarde a fait deux victimes, rue de Soubise. Il y a quelques jours, un habitant de cette rue, Monsieur Charles MALFAIT, tisserand, habitant la maison n° 10 de la Cour Saint Jean, avait recueilli un petit chien qui avait suivi son fils, Adrien. Il l’avait attaché dans la cour au moyen d’une corde assez solide. Lundi matin, à 8 heures, l’animal, après avoir rongé le lien qui l’enchaînait, prit la liberté et devenu subitement furieux, s’élança sur la première personne qu’il rencontra. C’était une enfant de onze ans, la jeune Hélène BOURGOIS dont les parents occupent le n° 9 de la Cour Saint Jean. Il lui fit une profonde morsure au-dessus du sourcil gauche.
Aux cris poussés par la petite fille, on accourut et on prévint aussitôt l’agent DESMARCHELIER de service dans le voisinage. Celui-ci chercha Monsieur le Docteur de CHABERT qui cautérisa la plaie au fer rouge. Hélène BOURGOIS ne souffre presque plus
Quant au chien, Monsieur ROGER, vétérinaire, le fit abattre et eut le regret de constater qu’il était atteint d’hydrophobie. Ayant appris que la veille Adrien MALFAIT avait été mordu légèrement à la main droite par la même bête, Monsieur le commissaire HENRY s’est empressé de l’envoyer à Monsieur le Docteur de CHABERT pour qu’on le cautérisât sans retard.
L’enquête continue : on veut découvrir l’origine de ce chien et on désire savoir s’il n’aurait pas également mordu d’autres personnes ou d’autres animaux de son espèce.
Le service de la charrette à chiens n’a point chômé durant ces deux jours : samedi et dimanche, on a dressé quatorze procès-verbaux et mis seize chiens en fourrière. En 1885 jusqu’au 1er octobre on a relevé 314 cas de rage canine dont 13 morts d’hommes ».
La rue de Soubise, le lieu du drame, est située assez près du centre de la ville. Elle part de la rue Sébastopol et rejoint la rue des Arts. Le rapport de 1869 indique que cette cour de 36 maisons avait 227 habitants soit environ 6 personnes par maison. Elle a la largeur minimum conseillée par la commission des logements insalubres soit 6 mètres entre les deux rangées de maisons. A Roubaix, à cette époque, la cour la plus large avait 18 mètres et la plus étroite, une vraie courée, n’avait que 2 mètres.
JOURNAL DE ROUBAIX DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 1885
» Monsieur PASTEUR vient d’être mis en possession de trois nouveaux sujets qui lui fourniront un champ intéressant d’observation pour l’application de sa méthode contre la rage.
Ces trois nouveaux sujets sont trois de nos concitoyens. Tout le monde sait que deux enfants, Adrien MALFAIT et Hélène BOURGOIS, habitant la rue de Soubise, ont été mordus, il y a quinze jours, par un chien enragé.
L’honorable Monsieur Julien LAGACHE a demandé dimanche matin par télégramme à l’illustre savant s’il consentait à les examiner et à les traiter. Monsieur PASTEUR a répondu, quelques heures après, par le télégramme suivant :
« Pasteur à Maire de Roubaix »
« Envoyer sans retard – Pasteur »
Les deux enfants dont il s’agit ont été immédiatement dirigés à Paris, sous la conduite d’un homme de confiance, Monsieur MARAIS, sous-inspecteur de la police de sûreté. On a découvert aussi qu’une troisième personne, Monsieur MAHIEU, avait été mordue par le même chien. On a envoyé, mardi soir, Monsieur MAHIEU rejoindre à Paris le jeune MALFAIT et la petite BOURGOIS.
Tous les trois seront soumis, par Monsieur PASTEUR, aux expériences qui ont été récemment pratiquées d’une façon si concluante sur d’autres sujets mordus par des chiens hydrophobes.
D’après le télégramme de Monsieur PASTEUR, le traitement doit durer dix jours. Tout le monde à Roubaix saura gré à Monsieur Julien LAGACHE de l’intelligence initiative qu’il a déployé en cette circonstance. »
LETTRE DU MAIRE A MONSIEUR LE PREFET DU NORD LE 5 NOVEMBRE 1885
« … Les enfants MALFAIT Adrien (19 ans) et BOURGOIS Hélène (11 ans), mordus rue de Soubise par un chien enragé, ont été conduits le 2 novembre au cabinet de Monsieur PASTEUR, par un homme de confiance, sous-inspecteur de la sûreté.
Le 4, un ouvrier, Monsieur Charles MAHIEU, qui avait été mordu par le même chien, a été adressé à son tour à Monsieur PASTEUR pour être soumis au même traitement.
Quant aux enfants dont il a été impossible d’obtenir l’entrée dans un hospice, ils restent à Paris, sous la surveillance du sous-inspecteur MARAIS, jusqu’à l’achèvement du traitement que Monsieur PASTEUR me dit devoir être terminé le 10 courant. »
JOURNAL DE ROUBAIX DU SAMEDI 7 NOVEMBRE 1885 : LES ROUBAISIENS EN TRAITEMENT CHEZ MONSIEUR PASTEUR
« L’illustre savant n’a pas de clinique, il n’est point attaché à un hôpital. C’est dans son laboratoire de la rue d’Ulm et dans ses annexes qu’il soigne en ce moment les trois Roubaisiens dont nous avons parlé.
Disons à ce propos que l’état et le nombre de leurs blessures ont été constatés par Messieurs les docteurs VULPIAN et GRANCHER. Le traitement de Monsieur PASTEUR est en apparence des plus simples : sous un pli fait à la peau, il inocule une demie seringue de Pravaz d’une moelle de lapin mort rabique. Cette inoculation est faite chaque jour pendant dix jours et à la même heure. C’est tout… »
LETTRES DU SOUS-INSPECTEUR MARAIS PARIS, LE 7 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
Je ne vous ai pas écrit plus tôt n’ayant encore aucun renseignement précis à vous donner au sujet de la santé des personnes à soigner.
Aujourd’hui, je puis vous répondre. Monsieur PASTEUR est très heureux que le vaccin ait pleinement réussi car aussitôt il s’est élevé des boutons sur le corps des personnes inoculées. Ce qui l’a persuadé de la guérison. Le 4 courant j’ai été à la gare du Nord où j’ai reconnu, répondant très bien au signalement, le nommé MAHIEU, que j’ai conduit chez le Docteur PASTEUR qui l’a inoculé immédiatement, promettant guérison.
Par ordre de Monsieur PASTEUR qui nous a lui-même désigné notre pension, rue de la Glacière n° 114 et notre hôtel pour y loger, même rue n° 71 où nous payons 2 francs par tête pour le logement et notre pension – 6 francs pour les hommes et 4 francs pour l’enfant. Le Docteur PASTEUR exige que ces personnes prennent de fortes nourritures pour renouveler le sang. Il recommande aussi beaucoup de distraction pour les enfants, leur empêchant de cette manière de prendre leur mal trop à cœur.
P.S. : J’ai oublié dans la présente de vous renseigner au sujet de l’inoculation qui se fait un jour à gauche, un autre jour à droite, à la ceinture et sous le côté. Il y a en ce moment en traitement, une vingtaine de personnes, soit de Dordogne, de la Bretagne et de différents départements.
PARIS, LE 8 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
Vous me demandez tous les jours des nouvelles des personnes à soigner, ce que je fais avec plaisir. Nous allons deux fois par jour, le matin à 11 heures et le soir à 9 heures pour les faire inoculer et chaque fois que Monsieur PASTEUR nous voit arriver, il crie « Vive le Nord » en voyant les enfants supporter l’inoculation sans souffrance aucune.
Monsieur PASTEUR, pour nous distraire, nous a gracieusement offert sa carte, nous permettant de cette manière de visiter, dans la semaine, tous les monuments et curiosités de Paris.
PARIS, LE 9 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
… Nous allons tous les jours chez Monsieur PASTEUR à 10 heures du matin pour l’inoculation et cela prend très bien, Monsieur PASTEUR m’a promis guérison complète.
PARIS, LE 10 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous annoncer que les personnes que j’accompagne, MAHIEU, MALFAIT et la petite BOURGOIS vont très bien. Le vaccin produit son effet. Ils sont tous plein de boutons. On les vaccine avec du virus de lapin. Monsieur PASTEUR nous a dit qu’il avait chez lui des chiens enragés et qu’il les guérissait à volonté mais qu’on ne pouvait pas les voir. Cela pourrait faire mal aux gens que j’accompagne qui sont atteints d’hydrophobie.
J’espère revenir à Roubaix le 11 ou 12 courant.
PARIS, LE 11 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
Le traitement de MAHIEU, MALFAIT et BOURGOIS est terminé. Monsieur PASTEUR leur a promis guérison. Nous serons revenus à Roubaix demain 12 courant par le premier train. Je n’avais pas pu vous dire jusqu’à ce jour, comment l’inoculation se faisait ; aujourd’hui, Monsieur PASTEUR me l’a dit, que c’était au 92e lapin qu’il faisait enrager et à celui-là qu’il prenait du virus pour inoculer les personnes par ce moyen il mettait la rage dans le corps des personnes plus fortes que celle existant et par ce fait il était sûr d’obtenir guérison. Il y a une vingtaine de chiens et singes et une grande quantité de lapins chez lui dans des cages qui sont très enragés pour prendre le virus tous les jours.
Nous sommes tous les jours, le matin, une vingtaine de personnes pour l’inoculation, de tous les pays, de l’Algérie, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de Bretagne, de Maubeuge, de Nevers, de Versailles et de Paris…
JOURNAL DE ROUBAIX DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 1885
Les trois Roubaisiens qui étaient en traitement chez Monsieur PASTEUR sont revenus jeudi après-midi, accompagnés de Monsieur le sous-inspecteur MARAIS qui ne les a pas quittés un instant pendant tout leur séjour à Paris. Ils sont rentrés enchantés de ce qu’ils ont vu et du traitement que leur a fait suivre l’illustre savant. Comment, d’ailleurs, ne garderaient-ils pas un bon souvenir de Paris ? On les a guéris, choyés et cités dans les journaux. Ils logeaient à l’Hôtel des Arts Réunis 71, rue de la Glacière. Tous les matins à dix heures, ils se rendaient au laboratoire de la rue d’Ulm et y restaient jusqu’à 11 heures. C’est pendant ce temps qu’on leur faisait les inoculations qui devait les préserver des terribles effets du virus rabique.
Nous avons vu cet après-midi la jeune Hélène BOURGOIS. C’est une fillette de onze ans, à la mine très éveillée. Elle ne cesse de vanter la paternelle bonté de Monsieur Pasteur et de ses aides. Cette enfant se plaisait si bien à Paris qu’elle y serait, dit-elle, volontiers restée, d’autant plus que ses deux oncles y demeurent. Son père, ouvrier apprêteur, est sans travail depuis cinq semaines ; aussi a-t-il regardé comme une véritable bénédiction du ciel le concours que lui a prêté l’administration municipale pour sauver sa fille. Hélène BOURGOIS, qui avait été cruellement mordue à l’arcade sourcilière, a encore le front enveloppé d’un bandeau ; mais la plaie, cautérisée plusieurs fois, ne tardera plus à se cicatriser complètement.
La petite fille a, de même que le jeune MALFAIT et Monsieur MAHIEU, le corps couvert de pustules, conséquences naturelles répétées (du traitement) dont ils ont été l’objet. Depuis quelques jours, Monsieur PASTEUR traite plus de trente personnes mordues par des chiens enragés et nous dit Monsieur MARAIS, on ne sait ce qu’on doit le plus admirer, du talent de l’illustre savant ou de son excessive bonté.
Quand il voit de pauvres gens sans ressources ou envoyés par de petites communes rurales trop pauvres pour leur payer autre chose que le voyage, il s’informe de leurs besoins et subvient de ses propres deniers à leur entretien pendant tout le temps que dure le traitement.
Bien plus, quand il les renvoie, il leur fait un petit cadeau qui entretient leur reconnaissance, ainsi, il a donné à la jeune Hélène, une pièce de 20 sous « qu’elle ne doit jamais changer » et que la famille, ce dont nous la félicitons, est décidée à conserver comme un précieux souvenir.
Adrien MALFAIT a reçu de Monsieur PASTEUR, une boîte contenant de l’iodoforme qui doit servir à guérir sa blessure ; ajoutons que cette matière est d’un prix élevé pour des ouvriers peu fortunés. Aussi, dans la cour Saint Jean, le nom de Pasteur est en grande vénération. Vendredi, Monsieur MARAIS a remis à Monsieur le Maire de Roubaix, la lettre suivante qu’on lui avait confiée :
PARIS, LE 10 NOVEMBRE 1885
Monsieur le Maire,
Je m’empresse de vous informer que le traitement des trois personnes mordues que vous m’avez envoyées, est terminé.
Chacune d’elles, séparément, doit m’écrire et me donner des nouvelles de sa santé au moins une fois par semaine. J’ai eu grandement à me féliciter des soins et de l’esprit de discipline du sous-inspecteur de police, à qui vous aviez confié la garde de ces différentes personnes.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération très distinguée
Louis PASTEUR
Pour terminer, voici la savoureuse lettre de remerciements du plus âgé des Roubaisiens guéris par Louis Pasteur.
Monsieur Julien Lagache,
Maire de la Ville de Roubaix,
C’est avec des vifs sentiments de reconnaissance que je viens vous remercier des bontés que vous avez eu pour moi atteint par les cruelles morsures du chien enragé de la rue de Soubise, je n’ai cessé d’être de votre part l’objet de la plus grande sollicitude jusqu’à ma complète guérison et pour l’obtenir, vous n’avez pas hésité de m’envoyer à Paris suivre le traitement du grand Monsieur Pasteur.
Je ne vous cacherai pas, Monsieur le Maire que par la suite de mes cruelles morsures, j’étais devenue inquiet, abattu, je souffrais de la tête, j’avais l’humeur noire, sombre, je ressentais un malaise général par tout le corps.
En descendant à la gare de Paris, je fus de suite reconnu par Monsieur Alfred MARAIS, sous-inspecteur de la sûreté de Roubaix qui m’y attendait. Il vit bien l’état d’abattement dans lequel je me trouvais, par de bons mots de manière joviale et encouragements me secoua le moral, il me fit prendre quelques verres de liqueurs qui me réconfortèrent puis il me fit voyager dans la ville. C’est on peut le dire un gai compagnon, il paya presque toutes nos consommations. Je voulais lui donner les 25 francs restant de mes frais de voyage, il me les refusa disant que je saurai bien les garder.
Je fus conduit par lui-même à Monsieur PASTEUR (permettez-moi ici, Monsieur le Maire, de saluer ce nom aimé. L’avenir le bénira car son travail soulage les souffrances). Il vit bien de suite l’état de ma triste santé ; aussi par des paroles affectueuses comme il sait si bien les dire, il ranima mon courage et je pris confiance.
Je fus immédiatement avec les autres malades (il y en avait de l’Algérie) l’objet de soins les plus assidus, je fus vacciné à la ceinture du corps, il me fit 5 piqûres de chaque côté, je ressentis aux reins et à la tête un mal étrange, une lourdeur qui se dissipèrent comme par un enchantement après les premiers jours de ce traitement qui dura 10 jours et aujourd’hui, grâce à vous, Monsieur le Maire et aux bons soins du savant Monsieur Pasteur, aimé, chéri de tous les malades et désormais placé au premier rang des Grands Bienfaiteurs de l’humanité, me voilà sauvé d’une mort horrible.
Je ne l’oublierai jamais. C’est pourquoi je vous prie, Monsieur le Maire, d’en garder toute ma reconnaissance et d’agréer, s’il vous plaît, les salutations respectueuses de votre très affectionné et très reconnaissant serviteur.
MAHIEU Charles.
Voilà donc évoqué le témoignage de la guérison de trois Roubaisiens, tout au début de la mise en application de cette découverte merveilleuse que fut le vaccin contre la rage, mis au point par Louis Pasteur.